- Actualité
- Chronique
- 31/10/2016 à 09:31
L’Université américaine à Beyrouth, un exemple à méditer
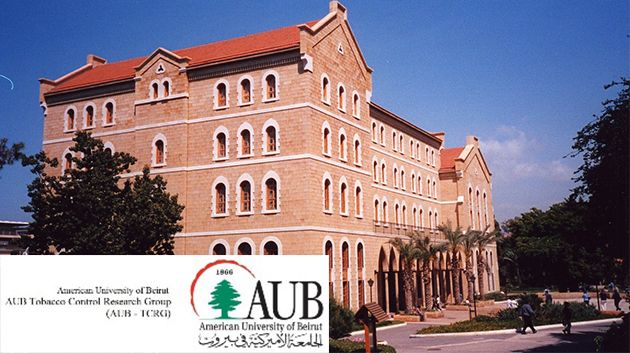
Par Mansour M’henni
Je ne suis pas un grand fan des Etats-Unis et encore moins un inconditionnel de leur façon d’être ou de faire ;mais je ne peux rester insensible à certains faits leur sont attribués et qui me paraissent bons à observer et à analyser, en vue de s’en inspirer, pourquoi pas !
J’entends déjà certaines voix qui m’accuseraient de crime contre le socialisme et de connivence avec l’impérialisme ; mais cela ne m’affecte plus car j’ai fini par comprendre que quand on est un inconditionnel de certaines idéologies, on se croit permis de prendre le noir pour du blanc et inversement. Je crois désormais qu’il faut apprendre à tout relativiser et à garder devant toute chose la distance qui se doit pour pouvoir discerner, en toute chose, le fil blanc du fil noir.
Ce qui vient d’être dit me permet d’exposer un avis né d’une visite à l’Université américaine de Beyrouth, au Liban, en marge d’un colloque international sur la Nouvelle Brachylogie, une discipline et un concept nés dans une université tunisienne (Université Tunis El Manar). Au début, je trouvais excessif que mes hôtes libanais insistent beaucoup sur l’importance d’une visite à l’Université américaine ; mais j’ai fini par me plier à leur suggestion avec quelques collègues de Tunisie et du Maroc.
Je voudrais vraiment passer outre de ce qui peut donner lieu à des conflits idéologiques en termes de couples opposés comme « libéralisme vs socialisme », « impérialisme vs indépendantisme », « capitalisme vs égalitarisme », etc. D’ailleurs ces conflits peuvent trouver d’autres raisons de chauffer quand on sait que cette université est un peu une ville dans la ville, un bijou archéologique qui date de 1866 (L’AUB fête son 150ème anniversaire), bien assis sur un monticule donnant sur la corniche de Beyrouth, comme une beauté typique exposant ses appas entre discrétion et coquetterie. Depuis sa création, plusieurs dons ont contribué à son extension et à sa prospérité : des USA, de Londres, d’Arabie et bien sûr du Liban.
Tout cela paraîtrait effectivement discriminatoire puisqu’il n’est pas donné à quiconque de suivre des études dans cette université. Très chère ! Oui, elle est vraiment très chère et il y aurait de quoi. Mais au-delà, ne peut-on pas s’en inspirer pour donner à nos universités certaines façons d’être et de faire qui, sans le besoin de grands moyens financiers, pourraient inspirer nos étudiants et responsables afin qu’ils soient au diapason du vivre civilisationnel indépendamment de tout ce qui serait de l’ordre de l’apparat ? Une façon d’être à la science, dont découle une façon d’être au civisme !
Un collègue a remarqué d’emblée la colonie de chats qui vivaient dans cette université, bien choyés et bien gardés à tel point qu’il n’était permis à personne de leur donner à manger, à part ceux qui en étaient chargés. Il s’est tout de suite exclamé : « Savez-vous que, remarquant qu’il y avait à son sens beaucoup trop de chats dans notre faculté, un de ses doyens n’a pas trouvé mieux, pour inaugurer son mandat, que de les décimer tous en leur donnant à manger une nourriture empoisonnée ?! ». Il y a sans doute là une différence à méditer, abstraction faite de toute manipulation idéologique.
L’AUB est ouverte à la visite publique et offre aux curieux un cadre bien soigné, un environnement propre, des vues superbes, une verdure apaisante abritant des bancs verts qui vous donnent envie de méditer, d’écrire ou de dessiner. Notre amie Dima Hamdan, coordinatrice de Brachylogia-Liban nous avoua qu’elle avait écrit son allocution d’ouverture du colloque sur un banc faisant face à la belle maison où habitent tous les présidents de l’université.
Au dos de chacun de ces bancs sont inscrits deux noms, en souvenir des intelligences ayant rayonné dans une spécialité ou une autre après sa formation à l’AUB. Quant à la bibliothèque, elle reste ouverte jusqu’à minuit, sept jours sur sept.
Voilà bien cette université qui avait démarré avec une classe de seize personnes ! Son fondateur, Daniel Bliss dont le nom est donné à la rue qui la longe, par le haut, avait ainsi défini les fondements de cette université : « Pour tous, sans état de classe sociale, sans souci de couleur, de nationalité, ou de religion. Tout homme, blanc, noir ou jaune, chrétien, juif, musulman ou athée, peut s'inscrire et avoir tous avantages de cet établissement pendant trois, quatre ou huit années ; et sortir en croyant en un Dieu, en beaucoup de dieux, ou en aucun Dieu.»
A voir de près chez nous, la Tunisie s’est dotée de plusieurs beaux bâtiments universitaires, souvent après leur démarrage dans des bâtiments récupérés. Qu’est ce qui empêcherait alors les Tunisiens d’en faire des lieux aussi agréables et aussi réconfortants, aussi disponibles et aussi accueillants ? Sans doute l’état d’esprit qui conçoit les lieux de la science comme des espaces privilégiés que tout citoyen a le devoir moral et citoyen de sauvegarder dans leurs plus belles images et dans le meilleur de leur fonctionnement.
Car, que peut-on attendre d’une personne ou d’un groupe de personnes qui ne respectent pas les lieux de la science ? Rien que la dégradation éthique, le déficit patriotique et l’ignorance caractérisée, même avec des diplômes décrochés à la va-comme-je-te-pousse.
De fait, tout est une question de culture de la science. Reste à savoir si nous avons fait ce qu’il faut pour cette culture et surtout si nous comptons le faire.



