- Actualité
- Chronique
- 30/10/2025 à 10:25
Retour encore… et toujours… à la vie associative
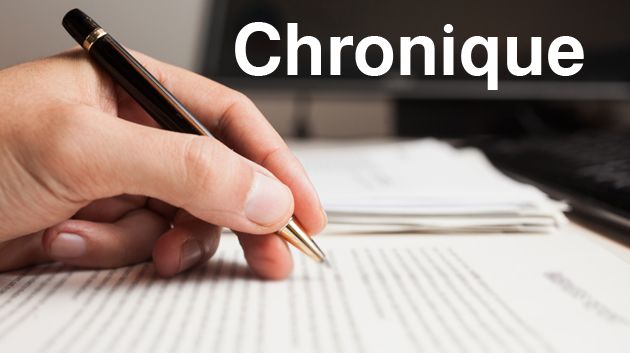
Par Mansour M’henni
Je reviens encore, dans cet espace d’expression, à l’action associative qui me paraît constituer un germe fondateur de la responsabilité citoyenne et un pilier fondamental de la construction sociétale. J’y reviens d’abord pour le triste constat que cette action souffre, ces dernières années, d’une négligence caractérisée qui ressemble à un assassinat à petit feu.
En effet, un vide inquiétant, de plus en plus vertigineux, enserre la dynamique associative avec pour objectif de la démunir de ses moyens et d’en détourner ses agents. Ceux de ces derniers qui résistent, par conviction, ressemblent plus à ceux qui prêchent dans le désert. D’autres s’associent à eux sur la base de calculs sournois relevant d’opportunismes particuliers ou de manipulations cyniques.
La vie associative, censée être un espace de rassemblement et de cohésion dans une communauté respectueuse des différences, devient alors, dans certains cas, un prétexte de séparatisme, de ségrégation et d’animosité, entre les générations, les genres, les ethnies, les idéologies, etc. Quelle mentalité avons-nous transmis à nos enfants et à nos jeunes concitoyens ou de quel lieu mystérieux leur est-elle venue pour leur apprendre à méconnaître ou à nier l’essentiel de ce qui constitue la plateforme de base de leur identité et de l’essence de leur être : ce qui fait leur culture et leur éthique ? Leur liberté d’être et de penser leur appartient certes, mais dans le cadre strict de la responsabilité partagée dans la communauté où ils vivent et où chacun a cette même liberté d’être et de penser qui doit être respectée ! C’est là que réside la responsabilité citoyenne et que l’expérience associative fait l’effet d’une école pratique de pédagogie conversationnelle.
À qui la faute, dirait-on ? À tout le monde ! Oui, la responsabilité est partagée, même s’il est possible de la considérer à des degrés variés de gravité ou d’imputabilité. La famille d’abord parce que l’éducation y commence et qu’elle n’y est pas seulement éducation au meilleur moyen de gagner l’intérêt personnel. Autrement dit, c’est là aussi que l’éducation à la citoyenneté commence. Examinons la part accordée, dans les familles, à l’éducation citoyenne des enfants, nous constaterons alors une défaillance fâcheuse qu’il importe certainement de corriger autant que faire se peut.
Mais la famille elle-même est déterminée par sa propre conscience de la responsabilité citoyenne et cette conscience est à la croisée de plusieurs conditions, de plusieurs facteurs et de plusieurs intervenants. Une famille est aussi le produit d’une école, l’école de société dont l’école d’enseignement n’est pas exclue. Mais c’est l’école des rapports réciproques qui agit le plus sur la famille.
Les conditions sociales d’une famille sont déterminantes de l’ensemble des valeurs auxquelles une famille finit par s’aligner : On a alors la morale du chacun pour soi et après moi le déluge, ou alors la morale de la solidarité et du destin partagé. Celle-ci, celle qui prévaut, est nécessairement partagée entre d’un côté l’État et ses instances de gestion et de gouvernance, de l’autre la société civile et les structures qui s’y constituent sur la base du volontariat pour le service public pluridimensionnel.
C’est là qu’on peut saisir l’importance de la vie associative qu’il faut certes soumettre à un contrôle adapté, mais qu’il ne faut nullement chercher à étouffer ou à vider de ses moyens.




